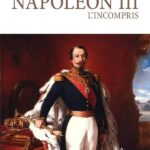Il y a quelques jours, Paul Lenglé nous créditait d’un très bon article sur la reprise de contrôle de l’immigration. Je me permets dans les lignes qui suivent, d’apporter certaines précisions et certaines pistes supplémentaires.
Depuis plusieurs décennies, la France semble prise dans un étau concernant sa politique migratoire. D’un côté, elle est tenue par des engagements juridiques européens et internationaux ; de l’autre, elle est confrontée à des défis croissants sur son territoire en matière de maîtrise des flux migratoires, d’exécution des décisions administratives (notamment les OQTF) et de cohésion nationale. Pourtant, si ces contraintes sont réelles, elles ne doivent pas masquer une réalité plus fondamentale : la faiblesse structurelle de la volonté politique nationale.
Des contraintes juridiques réelles mais non absolues
La France est soumise au droit européen (traités, règlements, directives) et aux jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Ces normes encadrent les politiques d’asile, de regroupement familial, et de traitement des étrangers en situation irrégulière. Néanmoins, ces règles laissent une marge d’interprétation et d’action non négligeable.
Plusieurs États européens, confrontés aux mêmes textes, ont su ajuster leur politique migratoire, renforcer leur diplomatie bilatérale, ou même imposer un cadre national plus strict — tout en restant dans les limites du droit. La France, à l’inverse, donne souvent le sentiment de se retrancher derrière des contraintes juridiques, là où un choix politique clair pourrait être fait.
L’évitement comme ligne politique
Ce constat révèle une forme d’évitement généralisé. Au-delà des clivages partisans, peu de gouvernements, au fil du temps, ont voulu assumer une ligne migratoire ferme et cohérente. On observe soit une gestion technocratique et désincarnée du sujet, soit une instrumentalisation idéologique, souvent émotionnelle, et rarement suivie d’effets.
Une telle posture engendre une défiance croissante de la population vis-à-vis des institutions. Elle alimente également la confusion entre immigration légale, immigration clandestine, droit d’asile, et intégration, faute d’un discours clair et responsable.
Une question centrale : les binationaux délinquants
Parmi les situations les plus épineuses figure celle des étrangers en situation irrégulière ayant commis des actes de délinquance, et plus particulièrement des binationaux. Ces derniers, étant juridiquement français, ne peuvent être expulsés vers leur second pays sans déclencher un conflit juridique, voire diplomatique.
Nombre d’États d’origine refusent de reconnaître la responsabilité de reprendre un individu qu’ils considèrent également comme français. La France se retrouve alors démunie, sans levier réel d’action. Il en résulte un sentiment d’impuissance, mais aussi de frustration chez les citoyens, face à ce qui apparaît comme un défaut de souveraineté et de justice.
Ce type de situation pourrait justifier, dans des cas extrêmes (terrorisme, trahison, atteinte grave à la sécurité nationale), une réflexion sur la déchéance de nationalité, à condition qu’elle soit strictement encadrée par le droit. Cette mesure, hautement symbolique, ne peut être utilisée à la légère, mais elle demeure un outil de souveraineté dont il serait incohérent de se priver par principe.
Un angle oublié : l’immigration “maritale”
Un autre aspect rarement évoqué dans le débat sur l’immigration est celui de l’immigration par mariage, aussi appelée “immigration familiale par union”. Chaque année, des milliers de ressortissants étrangers obtiennent un titre de séjour en France à la suite d’un mariage avec un citoyen français — qu’il soit de souche ou d’origine étrangère lui-même. Ce droit, reconnu par le Code civil et par la Convention européenne des droits de l’homme (droit à mener une vie familiale normale), ouvre rapidement la voie à une régularisation, puis à une naturalisation.
Bien que légale et souvent sincère, cette forme d’immigration n’est pas exempte de problématiques sous-jacentes :
- D’une part, l’existence de mariages “de complaisance” ou frauduleux, parfois encouragés par des réseaux organisés.
- D’autre part, la persistance d’un décalage culturel important dans certains cas, qui rend l’intégration du conjoint étranger complexe, voire conflictuelle dans certaines régions ou quartiers.
- Enfin, l’effet cumulatif de cette immigration “invisible” contribue à modifier en profondeur la démographie migratoire, sans que cela ne fasse l’objet d’un vrai débat démocratique.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le droit au mariage ni le droit à une vie familiale, mais d’ouvrir un regard lucide sur les conditions d’octroi des titres de séjour dans ce cadre, de renforcer les contrôles en amont, et de mieux évaluer les conséquences à moyen et long terme. La politique migratoire doit aussi pouvoir s’appuyer sur une vision cohérente de l’intégration et de l’harmonisation culturelle, y compris dans le cadre de l’union conjugale.
Vers une refondation sereine de la politique migratoire
La refondation d’une politique migratoire crédible repose moins sur un changement de cadre juridique que sur un changement de posture politique. Cela suppose :
- D’assumer un discours de vérité, ni alarmiste, ni angélique,
- De renouer avec une diplomatie active et conditionnelle avec les pays d’origine,
- De mettre en œuvre une application rigoureuse des décisions administratives,
- Et de clarifier le statut et le traitement des binationaux délinquants dans le respect des principes républicains.
Une telle démarche suppose du courage, de la constance, et une capacité à dépasser les clivages idéologiques. La maîtrise de la politique migratoire ne se décrète pas ; elle se construit dans la durée, avec sérieux et lucidité.
Enfant du Comminges, dans les Pyrénées Centrales, j’ai cet amour pour les territoires qui au fil des siècles sont venus former notre belle France. Cette France que j’ai servi durant quelques années au sein des unités de l’Infanterie de Marine et par ce biais sur différents théâtres d’opérations et qui m’a donné ainsi une deuxième famille. Amoureux de notre Histoire mais surtout admirateur de l’œuvre de nos deux empereurs, loin de tous anachronismes, je défends leur mémoire mais aussi les valeurs qu’ils nous ont légué pour une certaine idée de la France grande, juste, respectée et généreuse. Cette Histoire, ces valeurs et cette mémoire qui doivent nous rendre fier d’être Français.