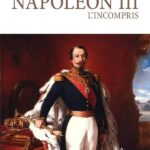La participation est une idée politique et sociale qui vise à associer les travailleurs à la vie de l’entreprise. Cela signifie qu’au lieu d’être seulement des salariés, les employés pourraient aussi donner leur avis, recevoir une part des bénéfices, ou même posséder une partie de l’entreprise. Deux grands hommes politiques français ont défendu cette idée : Napoléon III et le général de Gaulle, chacun à leur époque.
Napoléon III : une démocratie sociale
Au milieu du XIXe siècle, Napoléon III, neveu de Napoléon Ier, devient président, puis empereur. À cette époque, la révolution industrielle transforme la société, mais crée aussi des inégalités et des tensions entre riches patrons et pauvres ouvriers.
Napoléon III pense qu’il faut rapprocher ces deux mondes. Pour cela, il défend l’idée d’une « démocratie sociale », où les ouvriers ne sont pas seulement des exécutants, mais participent à la réussite de l’entreprise, notamment en recevant une part des bénéfices. Il s’inspire des idées socialistes modérées, comme celles de Saint-Simon.
Un exemple concret : l’industriel Laroche-Joubert, patron d’une imprimerie à Angoulême, met en pratique ces idées en instaurant une forme de participation aux bénéfices pour ses ouvriers. Il crée même un conseil ouvrier, une innovation remarquable à l’époque. Napoléon III soutient et met en avant ce type d’initiative dans ses discours.
Même si ces expériences restent limitées, elles montrent que l’idée de participation commence à se concrétiser.
Le général de Gaulle : unir capital et travail
Un siècle plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle revient au pouvoir. Il veut reconstruire la France, mais aussi moderniser la société. Comme Napoléon III, il pense que le conflit entre patrons et ouvriers est mauvais pour le pays. Il propose donc une solution originale : la participation.
Pour de Gaulle, la participation repose sur trois piliers :
Participation aux décisions : les salariés doivent avoir leur mot à dire dans la gestion de l’entreprise.
Participation aux résultats : ils peuvent recevoir une part des bénéfices.
Participation au capital : ils peuvent devenir actionnaires, donc co-propriétaires.
Cette vision donne naissance à des lois dans les années 1960, comme celle de 1967, qui instaure l’intéressement et la participation obligatoire dans certaines entreprises.
Un outil de patriotisme économique
Pour le général de Gaulle, cette participation ne sert pas seulement à apaiser les tensions sociales : elle vise aussi à renforcer l’unité du pays autour de son économie. En associant les Français au bon fonctionnement des entreprises, il encourage un patriotisme économique : chacun se sent responsable de la réussite collective et de la prospérité nationale.
De cette manière, l’économie n’est plus seulement l’affaire des chefs d’entreprise ou de l’État, mais de tous les citoyens.
Une même idée pour deux époques
Même s’ils ont vécu à des siècles différents, Napoléon III et le général de Gaulle partagent une idée commune : impliquer les travailleurs dans la réussite économique, pour renforcer l’unité nationale et éviter les conflits sociaux. Leur vision de la participation cherche à créer un lien plus juste entre capital et travail, tout en développant un sentiment d’appartenance à la nation à travers l’économie.
Enfant du Comminges, dans les Pyrénées Centrales, j’ai cet amour pour les territoires qui au fil des siècles sont venus former notre belle France. Cette France que j’ai servi durant quelques années au sein des unités de l’Infanterie de Marine et par ce biais sur différents théâtres d’opérations et qui m’a donné ainsi une deuxième famille. Amoureux de notre Histoire mais surtout admirateur de l’œuvre de nos deux empereurs, loin de tous anachronismes, je défends leur mémoire mais aussi les valeurs qu’ils nous ont légué pour une certaine idée de la France grande, juste, respectée et généreuse. Cette Histoire, ces valeurs et cette mémoire qui doivent nous rendre fier d’être Français.