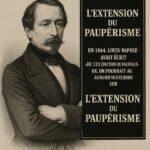Entré en vigueur en 1986 dans un relatif silence, l’Acte Unique européen a été présenté comme une simple évolution de la construction européenne. Il fut en réalité une révolution silencieuse : celle qui a transféré le cœur de la décision politique hors des mains des peuples. Ce traité a fondé une Europe du marché, de la concurrence “libre et non faussée” et de la dérégulation — contre l’Europe des nations libres et des souverainetés populaires. Il est temps d’en mesurer les effets, et de poser la seule vraie question démocratique : en sortir, ou s’y soumettre.
I. Le tournant silencieux de 1986
L’Acte Unique est signé en 1986 et entre en vigueur en 1987. Il fixe l’objectif de créer, d’ici 1993, un « marché unique » européen fondé sur les quatre grandes libertés : circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes.
Derrière cette promesse d’un espace économique fluide, se joue une transformation profonde : les États perdent progressivement leur capacité à contrôler leur économie, leur fiscalité, leur industrie, leur agriculture. L’Europe cesse d’être un cadre de coopération entre nations souveraines pour devenir un marché autorégulé où la concurrence remplace la volonté politique.
Le traité est ratifié sans référendum par les 12 états membres avec le soutien appuyé de Jacques Delors. La rupture démocratique est immédiate, mais peu visible.
II. Un désarmement économique général
L’Acte Unique a des effets structurels décisifs :
-
Monnaie unique : L’union économique et monétaire a accéléré le projet de création d’une monnaie unique, ce qui a été l’un des éléments déclencheurs de la perte de compétitivité de notre économie.
-
Libéralisation des capitaux : les mouvements de capitaux sont ouverts sans condition, y compris vers les pays tiers. Résultat : financiarisation de l’économie, multiplication des délocalisations, perte de souveraineté monétaire et budgétaire.
-
Fin de l’exception agricole française : la Politique Agricole Commune (PAC) se met au service du libre-échange. La mise en concurrence entre agriculteurs européens pousse à la concentration, à l’endettement, à la disparition des exploitations familiales.
-
Encadrement des politiques industrielles : les aides publiques sont restreintes, sauf en cas d’accord de la Commission. L’État ne peut plus protéger ses secteurs stratégiques. Cela mène à la désindustrialisation progressive.
-
Droit européen supérieur au droit national : par la jurisprudence et les traités ultérieurs, le droit communautaire prend le pas sur les constitutions. Le Parlement français devient une chambre d’enregistrement.
En somme, l’Acte Unique est un désarmement économique et stratégique unilatéral, sous habillage juridique.
III. Un acte contre la République sociale
L’idéologie du marché unique ne tolère pas les logiques de solidarité, de planification ou d’égalité.
Dès les années 1990, les services publics sont ciblés comme des « monopoles ». Les privatisations s’enchaînent : France Télécom, EDF, GDF, La Poste, les autoroutes, les aéroports. Les règles de concurrence libre et non faussée sont utilisées pour interdire la régulation, casser les statuts, flexibiliser les droits.
Le dumping social devient un levier : sans harmonisation européenne des salaires, du droit du travail ou de la fiscalité, la compétition pousse les États à détricoter leurs protections. Le modèle social français, construit dans l’après-guerre, est systématiquement attaqué.
Cette Europe-là n’est pas une chance. C’est un piège, soigneusement refermé.
IV. Reprendre le contrôle démocratique
Aujourd’hui, aucun sursaut politique n’est possible sans remettre en cause les fondements de l’Acte Unique.
Refonder une politique économique cohérente nécessite :
-
de restaurer les contrôles de capitaux,
-
d’imposer une préférence nationale dans les marchés publics,
-
de protéger nos filières stratégiques par des aides ciblées,
-
de renationaliser les grands services publics,
-
de reconstruire une souveraineté monétaire, fiscale, agricole et sociale.
Tout cela est interdit dans le cadre actuel.
Cela implique donc une rupture : sortir unilatéralement du marché unique, ou désobéir frontalement aux traités. La légitimité démocratique, celle du suffrage universel, doit primer sur les dogmes juridiques bruxellois.
Ce n’est pas une nostalgie, ni un isolement. C’est une condition de survie, pour rebâtir un État stratège, planificateur, protecteur — au service du peuple qui est là non pas pour faire fonctionner le marché à tout prix, mais pour l’encadrer.
Notre devise doit être : “autant de marché que possible, autant d’état que nécessaire”.