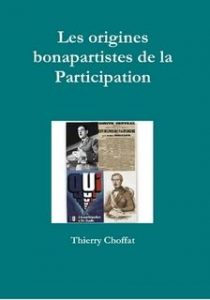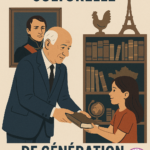L’idée de participation, souvent éclipsée par les grands débats idéologiques du XXe siècle, constitue pourtant l’un des fondements les plus audacieux et les plus modernes de la pensée politique française. Défendue avec constance par les bonapartistes depuis Napoléon III, et portée au cœur du projet gaullien, la participation n’est pas seulement un outil de justice sociale : elle est aussi un levier puissant de patriotisme économique et de souveraineté nationale.
Une tradition politique enracinée dans l’histoire française
Pour Napoléon III, la question sociale ne se règle ni par la charité, ni par la révolution, mais par l’association des forces productives. Dès les années 1850, il imagine une société où le capital et le travail ne sont plus ennemis, mais alliés. Dans ses discours, il parle d’”association du travail et du capital”, concept précurseur de la participation moderne, et qui vise à rendre aux travailleurs une part de la maîtrise économique de leur destin.
Cette vision s’inscrit dans la logique bonapartiste : réconcilier l’ordre et le progrès, l’autorité et la justice sociale, le peuple et l’État. Elle préfigure déjà un modèle français alternatif, ni libéral, ni marxiste, profondément enraciné dans l’intérêt national.
La participation chez de Gaulle : un projet de civilisation
Le général de Gaulle, héritier spirituel du bonapartisme social, reprend cette idée et l’inscrit dans son ambition pour la France. À ses yeux, la participation est la clef de voûte d’un modèle de société fondé sur la responsabilité, la solidarité et la souveraineté.
Elle ne se limite pas à une réforme des relations de travail : elle est une réforme des mentalités. En donnant au salarié une part dans la gestion, dans les résultats et même dans la propriété de l’entreprise, la participation crée une nouvelle citoyenneté économique. Elle renforce le lien entre l’homme et l’outil de production, entre le citoyen et la nation.
Un pilier du patriotisme économique et de la souveraineté nationale
Dans un monde où les capitaux se déplacent plus vite que les idées, où les grandes entreprises délocalisent au mépris de l’intérêt national, la participation offre une réponse concrète et puissante. En enracinant l’entreprise dans son territoire, en donnant aux salariés une voix et une part, elle oppose à la logique spéculative une logique d’enracinement, de responsabilité, de long terme.
La participation favorise la rétention des richesses produites en France, la fidélisation des talents, et la résistance aux logiques de prédation. Elle devient ainsi un instrument de patriotisme économique, car elle redonne au corps social français la maîtrise de son destin productif.
Elle est aussi un outil de souveraineté économique, car une nation forte économiquement est une nation où les décisions stratégiques sont prises par ceux qui vivent, travaillent et investissent dans la durée sur son sol.
Une idée d’avenir, plus actuelle que jamais
Dans un contexte de tensions géopolitiques, de fragmentation sociale et de crise écologique, la participation offre une vision cohérente, réaliste et profondément française d’un capitalisme à visage humain. Elle remet l’homme au centre de l’économie, la nation au cœur de la stratégie, et l’unité au fondement de la prospérité.
Le moment est venu de redonner à cette idée sa place dans le débat public. Non pas comme une utopie sociale, mais comme un projet de reconquête nationale.