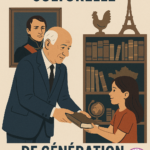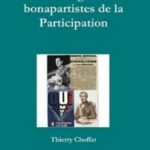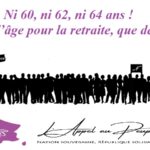Dans un monde globalisé, où les références s’uniformisent et les imaginaires s’internationalisent, affirmer la souveraineté culturelle, c’est affirmer une liberté essentielle : celle d’un peuple à rester maître de son récit, de son goût, de ses symboles et de ses valeurs.
La souveraineté culturelle, c’est d’abord notre Histoire. Elle est longue, parfois tourmentée, mais toujours fondatrice. De Clovis à De Gaulle, de la Révolution à la Résistance, de Napoléon Ier à Napoléon III, notre passé n’est pas un poids, il est un socle. Il nous raconte, il nous enseigne, il nous unit.
C’est ensuite nos territoires : la diversité des paysages, des accents, des traditions locales qui, des rives bretonnes aux vallées corses, en passant par l’Outre-mer, composent un patchwork d’identités enracinées et fières. Chacun porte une part de France.
C’est aussi notre gastronomie, classée au patrimoine immatériel de l’humanité, fruit d’un savoir-faire transmis, d’un art de vivre, d’un rapport au temps et au partage. À travers un plat, une recette, un produit du terroir, c’est un peuple qui parle.
Ce sont nos écrivains, nos penseurs, nos artistes, qui ont fait rayonner la langue française, façonné l’esprit critique, enchanté les générations. La culture, ce n’est pas que le divertissement : c’est l’âme d’une nation.
C’est enfin nos ouvrages d’art, nos monuments, notre capacité à bâtir, à célébrer le beau, le grand, le commun. De nos cathédrales aux ponts suspendus, de la tour Eiffel au château de Versailles, c’est un pays qui s’exprime dans la pierre, dans le fer, dans le geste.
Défendre la souveraineté culturelle, ce n’est pas se replier, c’est protéger ce qui nous rend singuliers, transmettre ce que nous avons reçu, et offrir au monde notre propre lumière. C’est refuser l’effacement, c’est préférer l’enracinement à l’oubli.