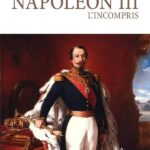Le bonapartisme, souvent résumé à un culte de l’autorité, est en réalité une doctrine profondément attachée à la souveraineté populaire. Héritier à la fois de la Révolution française et du génie administratif napoléonien, il propose une vision politique originale : un pouvoir exécutif fort, adossé directement au peuple, et une participation populaire ancrée dans les réalités locales. Ce double niveau — national et départemental — est au cœur de l’équilibre entre unité et expression démocratique.
Le référendum national : expression suprême de la volonté populaire
Dans la tradition bonapartiste, la souveraineté populaire ne se dilue pas dans les jeux parlementaires. Elle s’exprime directement, sans filtre, par le référendum. Napoléon Bonaparte, Napoléon III, puis le général de Gaulle en ont fait un instrument central de leur rapport au peuple. Mais ce référendum ne peut être convoqué à tout propos : il est une prérogative du chef de l’État, utilisée pour trancher les grandes questions d’intérêt national.
Le référendum est ainsi l’outil du lien direct entre le peuple et son chef. Il exprime une légitimité qui transcende les partis et donne à l’exécutif la force nécessaire pour agir au nom de l’unité nationale. Le général de Gaulle en a donné une leçon de rigueur en 1969 en se retirant après le rejet d’un référendum, fidèle à l’idée que seule la confiance populaire légitime l’autorité.
Une démocratie enracinée dans les départements : le RIC local
À l’échelle locale, le bonapartisme ne rejette pas la participation citoyenne, au contraire. Mais celle-ci doit s’inscrire dans des cadres solides et enracinés dans l’histoire nationale. C’est pourquoi le département, créé par la Révolution et consolidé par Napoléon, demeure le niveau légitime de l’administration territoriale. Il est équilibré, accessible, homogène : il incarne l’unité sans nier la diversité des territoires.
C’est à ce niveau que peut s’exercer un Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) local. Les citoyens, mieux informés et concernés directement, peuvent y intervenir sur des questions d’aménagement, de services publics, ou de vie locale. Ce RIC départemental ne remet pas en cause l’unité nationale, car il reste dans le cadre républicain et administratif défini par l’État. Il complète l’architecture bonapartiste : le pouvoir central reste le garant de l’unité, mais il s’appuie sur une démocratie de proximité.
Un équilibre entre unité nationale et expression populaire
Le bonapartisme, loin de tout centralisme rigide ou de populisme désordonné, propose une synthèse singulière : le chef de l’État incarne la nation, parle directement au peuple et décide par le référendum national quand l’intérêt suprême est en jeu. À l’inverse, la participation citoyenne s’exerce pleinement au niveau départemental, à travers un RIC local, inscrit dans une logique d’enracinement républicain.
Cette vision n’est ni nostalgique ni dépassée. Elle répond à une crise actuelle de représentation, de confiance et d’unité. Elle propose un cadre clair où chacun peut s’exprimer, mais où l’autorité reste légitime, forte et responsable devant la nation. En cela, le bonapartisme reste une des réponses les plus françaises et les plus modernes aux défis démocratiques de notre temps.
Enfant du Comminges, dans les Pyrénées Centrales, j’ai cet amour pour les territoires qui au fil des siècles sont venus former notre belle France. Cette France que j’ai servi durant quelques années au sein des unités de l’Infanterie de Marine et par ce biais sur différents théâtres d’opérations et qui m’a donné ainsi une deuxième famille. Amoureux de notre Histoire mais surtout admirateur de l’œuvre de nos deux empereurs, loin de tous anachronismes, je défends leur mémoire mais aussi les valeurs qu’ils nous ont légué pour une certaine idée de la France grande, juste, respectée et généreuse. Cette Histoire, ces valeurs et cette mémoire qui doivent nous rendre fier d’être Français.