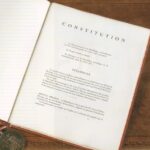Ni libéralisme orléaniste, ni nationalisme identitaire : le bonapartisme est une voie française qui conjugue État fort, Appel au Peuple et modernisation. À l’écart des figures médiatiques qui s’en revendiquent parfois sans en incarner les principes, ce courant continue d’exister dans des formes politiques cohérentes mais méconnues.
Une singularité française
Le bonapartisme est un malentendu permanent. Souvent réduit à une nostalgie impériale ou à un autoritarisme d’apparat, il est pourtant une tradition politique structurée, née des soubresauts de la Révolution française et de la volonté de maintenir l’ordre tout en poursuivant le progrès.
Issu de 1789, légitimé par l’Appel au Peuple et fondé sur une verticalité du pouvoir au service de la nation, le bonapartisme mêle souveraineté populaire, centralisation administrative, réformes sociales audacieuses, et affirmation de l’indépendance nationale. Il n’est ni réactionnaire, ni libéral. Il est républicain, social et national.
Contrairement aux idées reçues, le bonapartisme a toujours été progressiste : des réalisations sociales de Napoléon III (logement, droit du travail, syndicats) à la modernisation de l’administration, en passant par l’universalisation du suffrage, il repose sur l’idée d’un État fort qui agit pour le peuple, sans médiation partisane.
Zemmour, Lisnard : impostures bonapartistes
De nombreuses figures actuelles se parent d’un vernis napoléonien, mais ne relèvent en rien du bonapartisme authentique.
Éric Zemmour, admirateur du Premier Empire, incarne en réalité une vision ethno-nationaliste, nostalgique, identitaire, sans contenu institutionnel ni projet de réforme sociale. Sa rhétorique de décadence, son repli culturel, son absence de programme étatique marquent une rupture profonde avec le césarisme social et réformateur de la tradition bonapartiste. Zemmour aime Napoléon, mais trahit son héritage politique.
David Lisnard, quant à lui, se situe à l’opposé du spectre. Son programme repose sur le libéralisme économique, la subsidiarité, la décentralisation, et la limitation de l’État à ses fonctions régaliennes. C’est un orléaniste contemporain, défenseur d’une démocratie représentative allégée, d’une fiscalité contenue, et d’un ordre local fort — bien loin de l’ambition centralisatrice et plébiscitaire des Napoléon.
Ni l’un ni l’autre ne portent l’empreinte bonapartiste : l’un est conservateur-identitaire, l’autre libéral-technocrate. Tous deux reposent sur les partis ou les institutions classiques, là où le bonapartisme privilégie le lien direct entre le chef et le peuple souverain.
Le bonapartisme, tradition active
Et pourtant, le bonapartisme existe encore. Non plus dynastique, mais politique.
Il s’incarne aujourd’hui dans un mouvement explicitement nommé l’Appel au Peuple, dirigé par David Saforcada. Celui-ci se réclame ouvertement de l’héritage bonapartiste : chef issu du peuple, volonté de dépasser les partis, recentrage sur l’intérêt national, revalorisation de l’État, et refondation institutionnelle sur une base plébiscitaire. Ce courant porte une alternative claire à la logique actuelle de la démocratie représentative fragmentée : un exécutif légitime par le suffrage direct et un cap réformateur assumé.
Dans le champ des idées, Henri Guaino prolonge également cette tradition. Gaullien rigoureux, il incarne la convergence entre le bonapartisme républicain et le gaullisme originel, à travers une conception haute de l’État, une attention constante à la souveraineté, et une démocratie fondée sur l’unité populaire. Son attachement à une nation politique, inclusive mais exigeante, fait écho à la vision de Napoléon : tout citoyen fidèle à la République est pleinement Français.
Une matrice à redécouvrir
Le bonapartisme n’est ni une relique, ni une posture d’estrade. Il reste une matrice politique française cohérente, à la fois sociale, nationale et populaire. Face à la décomposition des partis, à la crise de la démocratie représentative, et à l’affaissement de l’autorité publique, il constitue une voie singulière, ni de droite, ni de gauche, mais profondément républicaine et souverainiste.
À l’heure des recompositions politiques, il mérite d’être redécouvert, non pas comme un passé glorieux, mais comme une alternative contemporaine pour ceux qui croient encore en la capacité de la France à se réinventer — par le peuple et pour le peuple.